

Dans les années 60-70, déjà, le mathématicien André Régnier avait donc tenté de lutter contre ce qu’il appelait à juste titre « Les infortunes de la Raison », titre de l’un de ses ouvrages !
La physique quantique démarrait son second demi-siècle et les principales théories de Werner Heisenberg étaient déjà trentenaires.
Toutefois, ses principales conceptions épistémologiques, qu’il avait du dissimuler pendant la guerre, n’étaient réellement connues que des ses proches amis, sous la forme du « Manuscrit de 1942 », édité seulement en 1984, huit ans après la mort du chercheur, et traduites en Français seulement à l’approche de l’an 2000…
Le mérite d’André Régnier, en 1970, est donc grand de tenter de s’en prendre à la déraison idéologique de Louis Althusser, qui se piquait non seulement de « science marxiste », mais d’un prétendu combat, au nom de ce « scientisme » dogmatique et révisionniste, en réalité, contre l’ « idéologie », précisément !
Une tentative judicieuse donc, de remettre les choses les plus évidentes en lumière, celle de la science réelle, et non alléguée comme faire-valoir d’une personnalité « universitaire » particulièrement surévaluée, encore aujourd’hui, par ses nombreux anciens adeptes, dispersés dans les horizons « politiques » les plus divers, réactionnaires, comme BHL, ou simplement toujours révisionnistes, comme la plupart.
Luniterre
les surprises de l’idéologie:
Heisenberg et Althusser
Par ANDRÉ RÉGNIER ,
Faculté des Sciences Bordeaux, 1970
De nos jours, le scientisme s’est fait concordataire. Le concordat passé par les scientistes pour sauver leur croyance en un savoir totalement légitime s’établit sur deux clauses. D’abord une amputation des ambitions du savoir ou du savoir lui-même, afin d’éliminer « l’erreur ». Ensuite, la sélection, dans le processus de construction du savoir, d’une démarche qu’on privilégie et à laquelle on confère une valeur absolue en tant que créatrice de vérité. Ainsi, dans les diverses variétés du positivisme, l’amputation est celle des notions et hypothèses spéculatives, la démarche privilégiée est l’expérience. Heisenberg, de son côté, fragmente définitivement le savoir en domaines d’expérience limités et privilégie la formation d’une représentation mathématique « close ». Althusser, chez qui la peur de l’idéologie sécrète la croyance qu’on peut séparer la science de l’idéologie, prétend amputer le savoir de ce qu’il contient d’idéologique et il privilégie la formation de concepts théoriques. Nous examinerons ici les cas d’Heisenberg et d’Althusser.
Dans « La nature dans la physique contemporaine », le premier des essais dont le recueil est paru sous le même titre, Heisenberg argumente comme suit : « Lorsque nous observons des objets de notre vie quotidienne, le processus physique qui rend possible cette observation ne joue qu’un rôle secondaire. Mais chaque processus d’observation provoque des perturbations considérables dans les particules élémentaires de la matière. On ne peut plus du tout parler du comportement de la particule sans tenir compte du processus d’observation. En conséquence, les lois naturelles, que dans la théorie des quanta nous formulons mathématiquement, ne concernent plus les particules élémentaires proprement dites, mais la connaissance que nous en avons » (p. 18) (1). On ne peut donc plus parler de nature en soi (p. 19). D’ailleurs, nous vivons dans un monde totalement transformé par l’activité humaine (p. 28) et « l’homme ne rencontre plus que lui-même » (p. 28). « Le sujet de la recherche n’est donc plus la nature en soi, mais la nature livrée à l’interrogation humaine » (p. 29). Cela impose une nouvelle conception de la vérité scientifique (p. 30) : nous devons renoncer à la description de la nature elle même (p. 30) et représenter la connaissance que nous en avons par des formules mathématiques (p. 30) qui permettent de prévoir le résultat des expériences sans risque de contradiction logique (p. 30) ; ainsi nous pouvons acquérir un savoir définitif, mais valable seulement dans des domaines limités de l’expérience (p. 31). « Le terme définitif, appliqué aux sciences exactes de la nature, signifie donc évidemment qu’il existe toujours des systèmes de concepts et de lois qui forment une totalité close et sont mathématiquement formulables ; ils valent pour certains domaines de l’expérience, pour ces domaines ils ont une validité universelle et ne sont susceptibles ni de transformation, ni d’amélioration. On ne peut naturellement pas espérer que ces concepts et ces lois soient aptes à représenter par la suite de nouveaux domaines de l’expérience » (p. 32). En conséquence, une connaissance ne peut être définitive qu’en acceptant d’être incomplète et en se reconnaissant pour telle (pp. 35-36). Le scientisme de Heisenberg se résume donc en trois propositions : 1 ) Une théorie est l’organisation logique d’un certain domaine d’expérience. 2) Elle est valable totalement et définitivement dans ce domaine et sans valeur hors de lui. 3) L’expérience se fragmente de façon nécessaire en différents domaines exclusifs les uns des autres. La première de ces propositions est la simple affirmation du nomina- lisme (2) et la discuter serait hors de notre propos. Remarquons simplement que le scientisme peut aussi bien être nominaliste que réaliste et qu’ici nous avons affaire à un scientisme nominaliste. Examinons la seconde proposition. Nous avons des centaines de milliers de connaissances aussi certaines que celle-ci : tout solide est attiré par la Terre, son centre de gravité suit un mouvement dont l’accélération est constante et est la même pour tous les solides. Mais regardons de plus près cette loi de la chute des corps. Si le solide tombe d’assez haut, la résistance de l’air annule son accélération ; si sa trajectoire est assez vaste, même en l’absence de résistance de l’air, il faut tenir compte du fait que la Terre est ronde, qu’elle tourne sur elle-même , que la force de la pesanteur diminue lorsque l’altitude croît et qu’elle varie avec le lieu, etc. Pire, compte tenu de la Relativité, la notion de solide s’effondre et aussi celle de centre de gravité. La loi de la chute des corps est donc une proposition où les mots ont perdu leur sens et qui, dans les conditions où l’on peut donner à ces mots une signification, doit être remplacée par une proposition qui la contredit. Que reste-t-il de cette loi ? Une relation quantitative approchée. Pourquoi ? Parce que l’approximation quantitative est une ruse qui nous autorise à nous contredire en affirmant ce qui est petit comme étant nul, dans les cas où il est négligeable, et comme étant non-nul, dans les cas où le négliger conduit à des conclusions fausses. Finalement, le vrai est vrai sauf quand il est faux. Heisenberg a donc bien raison de dire qu’il n’y a de vérités définitives que dans des domaines limités de l’expérience. Mais si c’est une consolation métaphysique de connaître l’existence de domaines limités où trônent des vérités définitives, du point de vue de la science cela ne nous sert à rien tant qu’on ne nous a pas fait savoir quels sont ces domaines et à quoi les reconnaître. Heisenberg dit que pour un tel domaine il y a des formules mathématiques qui permettent de prévoir, sans contradiction, les résultats des expériences. Examinons cela. Lorsque , d’une part, on a une expérience, et, d’autre part, une théorie mathématique qui est censée l’expliquer, on n’obtient pas cette explication sans faire des hypothèses d’application. Par exemple, si la chute d’une boule de billard est l’expérience et si la mécanique rationnelle est la théorie, celle-ci suppose les solides indéformables, donc nous supposerons la boule de billard indéformable et d’autre part nous l’assimilerons à une sphère homogène, ce qui situera son centre de gravité en son centre géométrique. Une théorie physique comporte toujours une schématisation des phénomènes dans le cadre de laquelle il faut faire entrer ceux-ci pour que la théorie leur soit applicable. Les hypothèses d’application ont comme première fonction de décrire le phénomène de telle façon qu’il entre dans la théorie ; leur seconde fonction est de spécifier le phénomène, de le décrire comme étant tel phénomène particulier. En conséquence, ce qu’une théorie explique, ce n’est pas une expérience, mais une expérience vue à travers certaines hypothèses d’application de cette théorie à cette expérience. Nous avons vu, à propos de la chute des corps, que les hypothèses d’application ne se contentent pas de simplifier les phénomènes, mais qu’elles en nient certains aspects ; en particulier, l’approximation, au nom de laquelle on déclare nul ce qui est tenu pour négligeable, se met d’entrée de jeu en contradiction avec toute expérience où ce négligeable cesserait de l’être. Toute explication chéorique, parce qu’elle schématise, finit toujours par entrer en contradiction avec l’expérience et, pour que la théorie permette de prévoir des résultats d’expériences, il faut non seulement que ceux-ci soient cantonnés à un certain domaine, mais encore que nous considérions l’objet comme relevant tantôt d’un domaine d’expérience et d’une théorie, tantôt d’autres. Autrement dit, pour éviter les contradictions entre les théories et l’expérience, il faut répartir celle-ci entre différents domaines incompatibles.
Si l’on tient à ce que les théories passent pour des vérités définitives, il faut poser comme irréductible l’incompatibilité des domaines d’expérience. Si l’on admet que les différents domaines d’expérience ne doivent pas demeurer incompatibles, mais qu’au contraire on doive s’efforcer de les réunir en une perspective unique, on devra admettre que toute théorie est en contradiction avec l’expérience par certains côtés et que le progrès du savoir devra lever cette contradiction, donc réviser les théories. En conséquence, il faut choisir entre la croyance aux vérités définitives et la décision de prendre comme un et un seul domaine d’expérience l’ensemble des observations relatives à un même objet. Heisenberg choisit les vérités définitives et admet la troisième des propositions par lesquelles nous avons plus haut résumé sa doctrine : l’expérience se fragmente en domaines exclusifs les uns des autres. Examinons cette troisième proposition. Au cours de son histoire, la science a parfois fragmenté l’expérience en domaines distincts ; parfois, au contraire, elle a réuni des domaines distincts de l’expérience. Les phénomènes terrestres, dans l’inépuisable variété sous laquelle ils apparaissent au sens commun, furent séparés des phénomènes célestes, qui montraient, pour une bonne part, une grande régularité, et l’astronomie se constitua comme science la première aboutissant à ce système de Ptolémée qui réussit même à enfermer à peu près ce qu’il y avait de moins régulier dans le ciel, le mouvement des planètes, dans le roulement régulier de cercles les uns sur les autres. Mais la mécanique céleste moderne procède de l’unification, par Newton, de la physique et de l’astronomie, unification pour laquelle Averroès et Kepler, entre autres, avaient milité et dont le système de Ptolémée mourut. Le même Newton sépara l’optique et la mécanique pour se débarrasser des idées empruntées à la seconde qui encombraient la première, mais la théorie de la Relativité réunifia ces deux domaines, la mécanique classique en mourut et, avec elle, toute une conception du temps et de l’espace. En gros, on peut dire que la science fragmente l’expérience pour trouver des lois, et que, pour la réunifier, elle révise ses principes. Dans le passé, des progrès fondamentaux de la physique théorique ont été dus à un effort pour unifier l’expérience ; sans de fortes raisons, on ne peut prétendre qu’il n’en sera pas de même dans l’avenir ; ces raisons, Heisenberg les trouve dans la perturbation des systèmes par l’observation. . Il est intéressant, en tout cas, de voir que Heisenberg lui-même en appelle à l’unification de l’expérience pour justifier son entreprise de construction d’une nouvelle mécanique, dans le papier de juillet 1925 qui le hissa d’un coup au rang des plus grands réformateurs de la physique : il y fait valoir que l’ancienne théorie quantique ne s’appliquait qu’à certaines propriétés de l’atome d’hydrogène et non à « un domaine clairement défini de problèmes quan tiques » (3).
Il nous reste à examiner l’argument par lequel Heisenberg justifie la thèse de la fragmentation définitive de l’expérience, argument tiré du fait que toute observation perturbe le système observé. Ce que nous venons d’exposer montre que c’est bien là la clef de voûte de la « nouvelle conception de la vérité » que Heisenberg nous propose avec ses fameuses « relations d’incertitude ». Ces relations sont une conséquence des principes de la mécanique quantique, elles sont relatives à certains couples de grandeurs physiques et montrent qu’on ne peut admettre, dans le cadre de la théorie, aucun système physique pour lequel les deux grandeurs d’un tel couple seraient simultanément déterminées avec une très grande précision : la précision de l’une limite la précision de l’autre et réciproquement. Si l’on veut que l’expérience ne démente pas ces vues théoriques il faut qu’elle ne fournisse jamais de système où les grandeurs d’un couple soumis à une relation d’incertitude auraient des précisions déclarées incompatibles par cette dernière. Sur ce point, la doctrine officielle est qu’on ne pourra jamais trouver dans l’expérience un tel système parce que la mesure d’une des grandeurs du couple perturbe l’autre grandeur et, plus précisément, parce que la mesure d’une grandeur avec une précision donnée limite la précision avec laquelle tout procédé de mesure de l’autre pourrait déterminer celle-ci. Les manuels de mécanique quantique et ceux de philosophie diffusent cette doctrine officielle avec une belle unanimité et aussi dans un commun mutisme concernant ses points faibles. Parmi ces derniers, il convient de noter le fait que, concernant les processus de mesure et les perturbations qui s’en suivent, jamais personne n’a fourni une liste déterminée de propositions telle qu’on puisse dire qu’on a affaire à une doctrine logiquement cohérente et qui, sans être contredite par l’expérience, rendrait effectivement compte des relations d’incertitude. Lorsqu’on essaye de dresser cette hste, on aperçoit d’emblée deux idées tout à fait évidentes. D’abord, que si l’on pose qu’un processus de mesure perturbe une grandeur, il faut distinguer la valeur de cette grandeur au début de ce processus et sa valeur à la fin. Ensuite, que c’est seulement pour les valeurs en fin de mesure que la perturbation peut jouer un rôle et, éventuellement, rendre compte des relations d’incertitude. En conséquence, dans cette interprétation des relations d’incertitude, il n’y a que less valeurs en fin de mesure à pouvoir figurer dans la mécanique quantique. C’est ce que disait d’ailleurs Heisenberg dès 1930 et il lui était d’autant plus nécessaire de l’affirmer que certaines valeurs en début de mesure sont accessibles à l’expérience et qu’elles enfreignent les interdictions édictées par les relations d’incertitude (4). On voit que si les relations d’incertitude obligent à se fragmenter en domaines incompatibles l’expérience dont rend compte la mécanique quantique, on ne peut en dire autant de l’expérience tout court (5). Et nous voilà privés de ce que nous avons reconnu plus haut comme la clef de voûte de la conception des vérités définitives chez Heisenberg. Nous examinerons ici la conférence d’Althusser pubhée sous le titre « Lénine et la philosophie ». Comme toile de fond, rappelons qu’Althusser voit dans le marxisme la science de l’histoire (p. 26) qui fonde une nouvelle pratique de la philosophie (p. 52), mais pour lui la philosophie marxiste n’existe pas encore (p. 26). Pour lui, Marx n’a pas écrit la « dialectique » qu’il projetait parce que les temps n’étaient pas mûrs (p. 30) et Lénine était né trop tôt pour la philosophie (p. 32). Après avoir « ri » de la philosophie (p. 10), et annoncé : « mon discours ne sera donc pas philosophique » (p. 11) mais un discours sur la philosophie (p. 11) «qui anticipe- sur ce qui sera peut-être un jour une théorie non-philosophique de la philosophie » (p. 11), Althusser nous propose sa conception des rapports entre la science et l’idéologie. Selon Althusser, la philosophie « représente » la lutte de classes auprès de la science et « représente » la scientificité auprès de la lutte des classes (p. 54). La philosophie « ne cesse d’intervenir politiquement dans les débats où se forme le destin réel des sciences » (p. 55), mais elle n’a pas d’objet (p. 44), pas d’histoire (p. 42), elle est le simple affrontement du matérialisme et de l’idéalisme (p. 44). La pratique scientifique a une tendance matérialiste spontanée (p. 41) et la philosophie matérialiste préserve cette pratique scientifique des assauts de l’idéologie, autrement dit, de la philosophie idéaliste (p. 50). Une science se constitue comme telle par une « coupure épistémologique » qui « élabore un système de concepts scientifiques nouveaux là où ne régnait auparavant que l’agencement de notions idéologiques » (p. 24) et fait ainsi de la science « le réel même, connu par l’acte qui le dévoile en détruisant les idéologies qui le voilent : au premier rang des idéologies, la philosophie » (23). Mais toute coupure épistémologique est une « coupure continuée à l’intérieur de laquelle s’observent des remaniements complexes » (p. 25). Par exemple, pour la biologie, une première phase de la coupure commence avec Darwin et Mendel et s’achève avec la biologie moléculaire (p. 25). Il y aurait quatre grandes coupures, celle qui a constitué les mathématiques, avec « Thaïes ou ceux que le mythe de ce nom désigne », celle de la physique, « avec Galilée et ses successeurs », celle de l’histoire avec Marx et, enfin, celle de Freud (pp. 24, 25). La coupure de la biologie n’a fait qu’intégrer celle-ci dans la physique (p. 25). Quant à la logique, elle est « en voie de se passer de plus en plus de la philosophie, elle est une science » (p. 48) qui appartient aux mathématiques (p. 25). Les grandes transformations de la philosophie suivent celles des sciences, notamment les coupures (p. 27) avec du retard (pp. 28, 30). Ainsi, après Thaïes vient Platon, après Galilée, Descartes, après l’axiomatisation, Husserl (p. 27).
Procédons d’abord à une critique expéditive. Si la position de concepts théoriques nous révélait « le réel même », on comprendrait mal que lorsqu’une théorie se trouve dépassée par une autre, comme la Mécanique classique par la Mécanique relativiste, ses concepts de base (termes primitifs) soient rejetés, ainsi que nous l’avons vu plus haut. Quant à l’idée que la vérité scientifique s’établit par la destruction de l’idéologie qui voile le réel, elle oblige à considérer la science d’aujourd’hui comme idéologie de demain. Par exemple, les principes de la Mécanique classique rendaient nécessaire un modèle mécanique de l’éther, à la recherche duquel les plus grands théoriciens de l’électromagnétisme perdirent un temps considérable jusqu’à la fin du XIXème siècle (6). La Mécanique classique, puisqu’elle voilait le réel, jouait donc le rôle qu’Althusser assigne à l’idéologie. Cela dit, qui nous paraît ruiner la théorie du progrès de la connaissance selon Althusser, passons aux conceptions de ce dernier concernant les rapports de la science et de la philosophie. Parlons d’abord de la logique. L’idée qu’on se fait d’elle est capitale dès qu’on parle des rapports entre science et philosophie et qu’on touche donc à la théorie de la connaissance. La définition axiomatique est le procédé qui permet de définir les termes premiers d’une théorie, de rendre les notions que celle-ci emploie indépendantes de toute autre notion que celles de la logique. C’est elle qui a permis de constituer une idée claire de ce qu’est une théorie, c’est elle qui a donné essor à la logique moderne et aux travaux sur les fondements des mathématiques. Si l’on veut parler de coupure, c’en est une, et de taille. La logique joue un rôle central en théorie de la connaissance puisqu’elle est l’unique présupposé de toute théorie achevée, c’est-à-dire axiomatisée. Cela pose la question de la valeur de la logique, question à propos de laquelle on pourrait bien être amené à parler de Hegel. Au contraire, pour Althussef, la logique est devenue une branche des mathématiques (p. 25). Cette idée est tout simplement fausse. En effet, par une « coupure », elle aussi de taille, Aristote comprit que la logique est formelle, qu’elle ne s’occupe que des relations entre les termes ou entre les propositions. Dès que des relations sont compliquées on invente des mathématiques pour les traiter, et c’est ainsi que les mathématiques ont fourni à la logique sa technique, mais une simple technique. Mais si la logique utilise donc pour sa technique un appareil mathématique, elle ne se développe pas comme une discipline mathématique car elle essaie, avec les logiques modales et quelques autres, d’embrasser des types de raisonnements de plus en plus larges qu’elle ne peut traiter seulement, comme on le fait des êtres mathématiques, à partir de leur seule définition, mais qui sont des faits concrets qu’elle a le plus grand mal à enfermer dans des définitions. La logique est mathématique comme la physique mathématique est mathématique, sans plus.
En affirmant que la logique est une science mathématique, Althusser, d’une part profère une absurdité, d’autre part ôte à cette logique son incidence philosophique, évite de parler de son rôle dans l’élaboration des autres sciences, lui épargne la critique hégélienne et, partant, épargne à la science les corollaires de cette critique. Concernant les rapports entre les mathématiques grecques et la philosophie de Platon, Althusser n’est guère plus heureux. Il impute à Thaïes l’invention des mathématiques, or il est bien établi que les Pythagoriciens sont responsables des premières démonstrations, sans lesquelles il n’y a pas de mathématiques proprement dites et qui distinguent les mathématiques pythagoriciennes du savoir géométrique et arithmétique antérieur. Si les mathématiques ont été fondées par une « coupure », c’est donc chez les Pythagoriciens qu’il faut la chercher. Quant à présenter Platon comme créant la philosophie sous l’influence de la « coupure » mathématique, cela réclamerait au moins un embryon de preuve. Que Platon ait été profondément imprégné de la pensée des Pythagoriciens, c’est un fait, mais la méthode essentielle des Pythagoriciens le raisonnement par l’absurde avait été utilisée à fond par les Eléates, un siècle avant Platon, et par Démocrite, son contemporain. Que les doctrines de ces gens n’aient pas été des philosophies est difficilement soutenable, à moins de jouer sur les mots et de vouloir dire par là qu’elles n’étaient pas que des philosophies. Opposant la science et la philosophie, Althusser est obligé de voir dans Platon comme le fait la tradition universitaire la plus réactionnaire le premier philosophe, puisqu’avant lui science et philosophie n’étaient pas séparées. Ainsi, parce qu’il veut voir à la fois la science et la philosophie s’opposer et la philosophie évoluer sous l’effet des progrès de la science, Althusser en arrive à trouver la conséquence philosophique de la « coupure » mathématique là où elle n’est pas, chez Platon, et non là où elle est, chez les Eléates. Voilà donc une première erreur historique engendrée par l’idéologie althussé- rienne. Althusser croit trouver aussi une illustration de sa thèse dans l’avènement du cartésianisme. Au premier abord, les apparences lui sont favorables. En effet, Galilée jette les premières bases de la dynamique ; Descartes propose ensuite une vision mécaniste de l’univers. Ce qui surprend un peu, c’est le choix de la coupure. Pourquoi Galilée et pas Newton ? Si la coupure consiste à poser des concepts, c’est Newton qui a posé ceux de la Mécanique et non Galilée. A moins de considérer seulement le concept d’inertie, ce qui peut se comprendre, mais alors il faut remonter à Jean d’Alexandrie. Admettons néanmoins Galilée. Mais la transposition cartésienne de la méthode mathématique dans les sciences du réel doit beaucoup au mathématisme d’inspiration platonicienne qui triomphe avec les lois de Kepler et fascine les savants à cette époque où Galilée écrivait : « la vérité que nous font connaître les démonstrations mathématiques est celle-là même que connaît la sapience divine ». Alors, pour pouvoir considérer les premiers résultats de la mécanique moderne comme une « coupure » génératrice de la philosophie cartésienne, il faudrait fournir une démonstration dont la possibilité est loin d’être évidente : l’influence du principe d’inertie ou des lois de la chute des corps sur la rédaction des « Regulae » ne semble pas déterminante. L’à-peu-près des vues d’Althusser concernant la logique, Platon ou Descartes, contraste fâcheusement avec son intention de tenir un discours scientifique sur la philosophie ; mais cela n’est rien devant cette profonde perversion de l’histoire des idées qu’entraîne la volonté d’opposer science et idéologie. Si nous entreprenons de dire ce qu’une époque créa de science et ce qui fut son idéologie, nous prenons une vue tout à fait extérieure à l’esprit de cette époque pour qui, bien évidemment, ce problème, même si elle se l’est posé, ne se présentait pas du tout comme à nous. Examinons quelques exemples. Les Pythagoriciens furent à la fois une secte mystique et la grande école scientifique de la fin du Vlème et du début du Vème siècle. Pour eux, la connaissance mathématique était un moyen de purification, et il est bien difficile de prétendre que leur volonté d’ascèse ait été pour rien dans le besoin de perfection qui les conduisit à découvrir les nombres irrationnels. Si ceux qui restèrent attachés au système de Ptolémée, après Copernic et après Newton, avaient une motivation idéologique évidente, ils avaient aussi un argument : la structure du ciel était hors de notre expérience, il fallait nous abstenir de spéculer à son sujet et nous limiter à mettre de l’ordre dans ses apparences. Et c’était là déjà la position de Ptolémée lui-même, celle qui justifiait son travail. La philosophie « spontanément matérialiste » des savants, comme dit Althusser, fit se ranger certains d’entre eux du mauvais côté lors de la bataille que livra Pasteur contre la théorie de la génération spontanée. On écrit partout que la Relativité fut inventée par Einstein en 1905. Il est exact, qu’en septembre 1905, Einstein donna aux Annalen der Physik son premier et décisif article « Sur l’ électrodynamique des corps en mouvement ». Mais le principe de relativité était antérieur : Poincaré l’énonçait et déclarait y croire dès 1900, au congrès international de physique de Paris (7). Lorentz l’affirmait sans équivoque en avril 1904 (8). En septembre de cette même année, Poincaré énonçait comme les grands principes de la physique : la conservation de l’énergie, la dégradation de l’énergie, l’égalité de l’action et de la réaction, la relativité, la conservation de la masse, la moindre action (9). Einstein, grâce à sa fameuse critique de la simultanéité, interpréta le principe de relativité de telle sorte que le principe des actions locales n’aurait absolument plus pu être omis d’une liste des grands principes de la physique et que le principe de l’égalité de l’action et de la réaction ne pouvait plus y figurer. Comme il le déclara plus tard, Einstein réussit ce coup de maître grâce au point de vue positiviste qui était le sien à l’époque (10) :il traita les événements physiques comme les résultats d’observations faites par des observateurs et non comme des faits objectifs. Bien que cette introduction des observateurs dans l’exposé de la théorie dénature des notions importantes, comme celle d’invariance, bien qu’Einstein ait, par la suite, pris vigoureusement position contre le positivisme (11), on continue à exposer la relativité en termes d’observateurs. Enfin, voici deux phrases prises dans l’introduction de l’article où Heisenberg fonda la mécanique quantique moderne : « dans cette situation, il semble raisonnable de renoncer à tout espoir d’observer les quantités jusqu’ici inobservables, comme la position et la période de l’électron, et d’admettre que l’accord partiel des règles quantiques avec l’expérience est plus ou moins fortuit. Alternativement, il semble plus raisonnable d’essayer d’établir une mécanique quantique théorique, analogue à la mécanique classique, dans laquelle figurent uniquement des relations entre quantités observables » (12). Ainsi, nous voyons et la religion et la philosophie tantôt s’opposer à une science nouvelle, tantôt en aider une à naître. De plus, dans le cas de la Relativité, et comme nous l’avons vu plus haut à propos des idées de Heisenberg, dans celui de la mécanique quantique, l’idéologie se trouve intégrée à la science pour plus d’un demi-siècle. Ces faits considérés, il faudrait beaucoup d’optimisme pour suivre Althusser dans sa croyance en une lutte historique entre la science et l’idéologie. En général, la connaissance scientifique progresse non pas sur un territoire inoccupé, mais au travers de combats contre des idées fausses qu’elle doit déloger de leurs repaires. Que sont ces idées fausses ? Pour Althusser, de l’idéologie. On voit bien les idées magiques chassées par la science, l’astrologie cédant la place à l’astronomie, l’alchimie cédant la sienne à la chimie, etc. ; mais au-delà de ces images d’Epinal, posons-nous des questions plus précises. Bien entendu, il y a dans la science des erreurs pures et simples, elles ont leur importance, mais laissons-les de côté. En mathématiques, où les erreurs sont généralement très vite détectées, donc tout à fait négligeables, il y a quand même des idées fausses. Un mathématicien connu disait, lors d’une interview télévisée : « Toutes les idées importantes sont des remises en cause » ; c’est un peu exagéré, car il y a des inventions mathématiques dont le caractère de remise en cause est secondaire, mais on pourrait sans aucune réserve soutenir que toute idée importante comporte une remise en cause. Mais puisqu’en mathématiques les résultats sont démontrés remise en cause de quoi ? Des idées qui ne sont pas des résultats, bien entendu. En mathématiques, lorsqu’une démonstration est bien faite, la proposition qu’elle établit ne saurait être mise en doute et ne peut se voir refuser le caractère scientifique. Cela considéré, on en conclut généralement que les mathématiques échappent aux influences idéologiques et constituent un savoir objectif. Il n’en est rien. Que chaque résultat mathématique soit objectif n’implique pas que l’ensemble de ces résultats le soit aussi. Dans le tas de cailloux du cantonnier, chaque caillou est naturel, mais le tas, en tant que tas, est fait par l’homme et il n’est pas naturel que tel caillou fasse partie du tas. De même, si chaque théorème mathématique est démontré, donc nécessaire dans sa conclusion, rien ne rend nécessaire qu’à un moment donné l’ensemble des théorèmes connus soit ce qu’il est ; cet ensemble change d’ailleurs de jour en jour, et pas seulement par accumulation, car des théorèmes disparaissent, se trouvant du jour au lendemain absorbés par des résultats soit plus généraux, soit plus puissants. A fortiori, cet ensemble des résultats mathématiques n’est pas déterminé uniquement par la nécessité interne de l’univers des êtres mathématiques, mais par les choix que les mathématiciens font de la direction de leurs recherches. On ne peut pas démontrer n’importe quoi, et certainement pas un résultat contradictoire aux résultats déjà démontrés, mais on ne démontre que ce qu’on a jugé bon de démontrer, et les mathématiques sont d’abord le produit des préoccupations des mathématiciens. Il faut aussi remarquer que ce qu’on démontre à chaque époque dépend de ce qu’on a démontré avant, donc de choix antérieurs, et, finalement, le développement des mathématiques est aventure où le hasard intervient, et non déploiement tranquille d’un ordre nécessaire. Et ne jette-t-elle pas un doute sur l’objectivité même de chacun des résultats la remarque que chacun de ceux-ci est menacé de disparaître par absorption dans un résultat plus général ou plus puissant ? Un résultat est objectif, mais son existence ne l’est pas. Pire, cette existence dépend d’un jugement de valeur, celui qui nous fait soit laisser le résultat tel quel, soit le creuser pour lui trouver un remplaçant. Qui croira que dans ces jugements de valeur on ne se trompe jamais ? Les mathématiques, pas plus qu’une autre science, ne se réduisent à un ensemble de résultats établis, et elles contiennent beaucoup d’idées fausses que leur développement remet en cause. De façon générale, on se fourvoie gravement si l’on identifie la connaissance scientifique avec l’ensemble des résultats obtenus par la science. Rappelons ici, quant aux résultats théoriques, ce que nous avons dit plus haut : chaque fois qu’on applique une théorie à un phénomène concret, on le fait par l’intermédiaire d’hypothèses d’application qui rendent le phénomène justiciable de la théorie en le décrivant d’une manière convenable. En fin de compte, les résultats théoriques demeurent vides si un autre savoir, qui porte sur eux et leur emploi, donc un savoir sur un savoir ou métasavoir, n’est pas là pour leur donner un contenu concret déterminé. Ce métasavoir, qui n’a rien de bien établi ni de scientifique, qui est un savoir pratique, constitue la connaissance théorique comme connaissance actuelle du réel, en fournissant le mode d’emploi des théories. Il ne saurait donc être question de réduire la connaissance scientifique aux résultats de la science et encore moins aux connaissances théoriques : donner un sens concret aux mots abstraits avec lesquels les résultats scientifiques sont exprimés relève d’une pratique et d’un métasavoir non- scientifique.
Le métasavoir dont nous parlons ici ne se borne pas à actualiser le savoir potentiel contenu dans les résultats scientifiques, il préside à l’étabhssement de ces résultats. En effet, les concepts constituant les théories ne sont pas produits par une « coupure », comme le croit Althusser, mais par un processus qui (métaphore pour métaphore) ressemble plutôt à une lente distillation, processus que Freud a décrit fortement en 1915 (13), et dans lequel, dit-il, « on ne peut éviter d’appliquer au matériel certaines idées abstraites que l’on puise ici ou là et certainement pas dans la seule expérience actuelle ». Le métasavoir joue le rôle principal dans le choix des sujets de recherche, un cas extrême étant celui où certains problèmes sont éludés parce que réputés non-scientifiques. Enfin, le départ entre ce qui est considéré comme scientifique et ce qui ne l’est pas est très souvent fait sur la base de considérations méthodologiques, et il n’est guère de grandes innovations théoriques qui n’aient donné heu à des disputes philosophiques. Ce fut le cas des idées de Copernic, de Newton, de Lagrange, de Maxwell, de Boltzmann, d’Einstein, de Heisenberg et de tant d’autres. L’influence du métasavoir sur les résultats scientifiques est donc considérable, ce métasavoir est lui-même très largement influencé par les idéologies, les résultats scientifiques sont donc souvent tributaires de quelque thème idéologique, heureux encore si le thème idéologique ne passe pas pour un résultat scientifique, comme en Relativité, ou en Mécanique quantique ainsi qu’on l’a vu plus haut. Résumons : La connaissance scientifique ne saurait être réduite à l’ensemble des résultats obtenus par la science et, encore moins, aux résultats théoriques ; elle est faite à la fois de ce savoir abstrait et d’un autre savoir qui donne au premier un contenu concret, qui le constitue comme vérité. Ce second savoir, que nous appelons ici métasavoir, joue également un rôle dans l’étabhssement des résultats théoriques et, comme il est influencé par l’idéologie, ces résultats sont eux-mêmes influencés par l’idéologie. De plus, nous avons vu aussi que l’influence de l’idéologie sur la science ne peut être traitée comme purement négative et mystificatrice, car elle est parfois, au contraire, stimulante et créatrice. Nous sommes donc bien loin du schéma althussérien selon lequel la scientificité réside dans des systèmes de concepts scientifiques que la « coupure épistémologique » substitue aux notions idéologiques. S’il était possible d’en énoncer un, quelque schéma général des relations entre la science et l’idéologie rendrait bien des services ; mais il ne nous semble pas que les althussériens soient partis dans une direction qui y conduise. Pour ce qui est de la métaphysique, nuls ne sont plus opposés que Heisenberg et Althusser. Le premier pose que le but de la science n’est pas de décrire la nature mais d’« exprimer la connaissance que nous en avons » ; le second pense que la science est « le réel même, connu par l’acte qui le dévoile ». Mais les deux croient trouver la vérité dans les « systèmes de concepts » scientifiques, donc au niveau théorique ; pour eux deux, la vérité est dans l’abstraction. Ayant pour fonction sociale de fournir des discours abstraits réputés vrais ils ne conçoivent « vrai » que comme attribut d’un discours abstrait. Qu’ils choisissent ces discours abstraits particuliers que sont les théories ne change rien à l’affaire car, celles-ci ayant un domaine de validité limité et dont la hmite ne nous est jamais exactement connue, reconnaître tel phénomène comme relevant de telle théorie reste l’acte par lequel de la vérité est donnée à cette théorie, laquelle ne peut pas en posséder intrinsèquement. Les théories ne sont pas des vérités mais des instruments pour produire des vérités.
(1)Les numéros entre parenthèses renvoient aux pages des ouvrages cités
(2)On trouvera une introduction à l’histoire des controverses entre physiciens réalistes et nomina- listes dans nos Infortunes de la Raison, ch. I, éd. du Seuil, 1966
(3) Zeit. phys. 33, p. 879.
(4) The Physical Principles of the Quantum Theory, p. 20.
(5) Voir à ce sujet notre Mise au point sur les incertitudes de Heisenberg, Atomes, 1955, pp. 299-302.
(6) Consulter par exemple, Whittaker : A History of the Theories of Aether and Electricity, 2ème éd., Th. Nelson, 1951.
(7) Rapports… Gauthier-Villars L, 1900, p. 21
(8) Amst. Proc. 6, 1904, p. 809.
(9)Bul. Se. Math 28, 1904, pp. 205, 306.
(10)Albert Einstein, Philosopher, Scientist, p. 21
(11) Ibid, p. 669.
(12) Zeit. Phys. 33, 1925, 879-880.
(13) Metapsychologie, éd. française, Gallimard, Coll. Idées, pp. 11, 12.
SOURCE >>>http://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1970_num_15_1_1264
https://www.persee.fr/docAsPDF/homso_0018-4306_1970_num_15_1_1264.pdf
Pour approfondir, un ouvrage d’André Régnier, disponible en ligne sur le site de la BNF >>>https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3364448d/
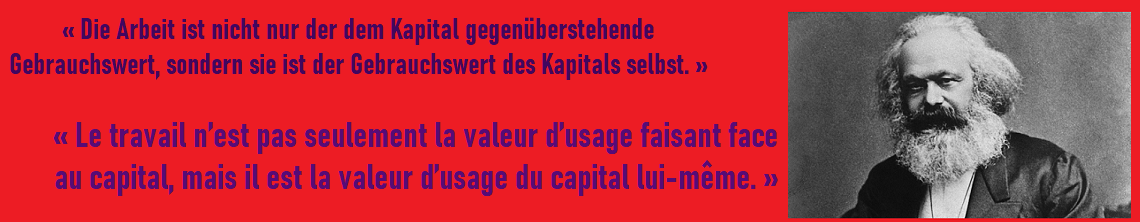

11 commentaires